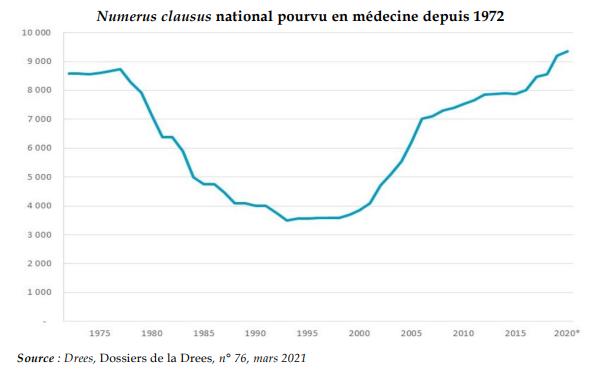Société
Le président du groupe Leclerc a réfuté les mises en cause qui pèsent sur la grande distribution, accusée de « chantage mortifère » par la ministre Annie Genevard, dans le cadre des négociations avec les agriculteurs. Michel-Édouard Leclerc pointe la responsabilité de « l’amont » de la filière - les grands industriels de l’agroalimentaire.
Le